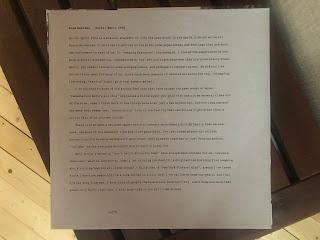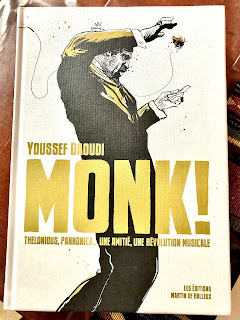Je vis par la musique. La mélomanie, je veux dire, parce que pour ce qui est de la pratique, je laisse ça à mes fistons qui ont le talent, eux. Moi, j’écoute et je vibre de tous mes atomes. Depuis toujours, à ce que je me souvienne. Toujours préféré les musiques lentes, une sorte d’adagiomanie qui me réconforte, la tristesse en musique me rassure me fait du bien. C’est cette préférence qui me fait aussi apprécier les musiques plus tordues et libre comme le free jazz, par exemple, comme la musique socialement engagée, mais ça c’est autre chose.
2020 plus que toute autre année a été propice à l’écoute musicale, confinés que nous fûmes de longs moments de l’année. L’un des albums qui albums qui a le plus marqué mon début d’année s’intitule Feuilles nocturnes. C’est du meilleur piano de Frédéric Chopin ( interprété par Evgeni Koriolov, le même qui a enregistré ces Bach d’anthologie : L’Art de la fugue (Tacet 13) et les Variations Goldberg (Hänssler Edition 112). Ce Chopin-ci a été soigneusement pensé comme une longue rêverie onirique. C’est tout plein d’une intense douceur, de tendres emportements, d’émotion délicate, de sourires bienveillants, de bienfaisante mélancolie. Si c’est excellent pour entretenir les insomnuits, c’est aussi magique au réveil que ça l’est, avec un Grand Marnier après le souper. C’est une musique qui brille au soleil et irradie sous la lune
Pour rester en l’esprit, en y ajoutant des couleurs et une forme de modernité, il y a eu le Debussy - Rameau du jeune (36 ans quand même) Islandais Vikingur Olafsson. Sérieux, un nom comme ça, ça ne s’invente pas! Mais bon. Après d’impressionnants albums de piano consacrés Philip Glass et Jean-Sébastien, voilà qu’il consacre un enregistrement à deux novateurs français, Jean-Philippe Rameau (1683-1764) dont les œuvres pour clavecin comptent parmi les plus expressives du 18 siècle et la musique pour piano de Claude Debussy (1862-1918). Il y a ici une sorte de sorcellerie à nous faire croire que ces musiciens sont frères d’âme, des coloristes nés. À cet égard, la pochette du disque est révélatrice à plus d’un titre, le pianiste pratiquant aussi la peinture. Coup de cœur assuré. Il n’est pas une semaine que j’y revienne depuis des mois. (Deutsche Grammophon 483 8283)
Ça sonne ainsi : https://www.youtube.com/watch?v=wChgk4qq3Kc
Ludwig fête ses 250 ans et, pour l’occasion, l’excellent Quatuor Ébène a fait le tour des cinq continents de la planète pour nous offrir l’intégralité des 16 quatuors du maître. Les grandes versions de ces œuvres, celles Berg et des Prazak entre autres, ne manquent pas. Pourtant, celle-ci m’a particulièrement fait vibrer, non seulement par la cohésion et l’engagement de l’ensemble, mais surtout par son intensité et l’émotion vive qui s’en dégage. De cette somme, je retiens particulièrement le 14e en do # mineur, op.131, de loin mon préféré, avec ses longs et riches mouvements lents qui te chavire le cœur à tout moment. Pour en connaître plus sur cette aventure qui s’échelonne sur 6 sans, il y a ce papier du journal Le Monde.
Si le Kronos Quartet, ce quatuor à cordes américain qui se « spécialise » dans les musiques de genres différents de continents différents et d’époques plus ou moins anciennes, il s’intéresse aussi aux folk songs de sa contrée d’origine. Après un fort bel album intitulé Folks Songs sorti chez Nonesuch en 2017, qui réunit quelques grandes artistes chanteuses (Olivia Chaney, Rhiannon Giddens, Natalie Merchant, et un gars, Sam Amidon), le Kronos Quartet célèbre, cette année, l’œuvre d’un grand maître du genre, musicologue, compositeur engagé, un passeur unique, Pete Seeger. Intitulé Long Time Passing, réunit une multitudes de chanteurs et choristes autour d’œuvre qui ont imprégnées les cultures nord-américaines à plus d’un titre : Turn, Turn, Turn; We Shall Overcome; If I Had a Hammer; Where Have All the Flowers Gone? pour n’en nommer que quelques-unes. C’est beau, riche et varié.
Pour comprendre de quoi il retourne, faut écouter cette version de Where Have All the Flowers Gone!
Le californien Ben Harper a fait de tout pas mal amalgamé au cours de sa carrière; blues, gospel, reggae, rock, funk avec, entre autres, The Innocent Criminals. En ce temps pandémique, il est revenu à ses sources, le folk. Ses grands-parents avaient fondé, dans les années 1950, un magasin de musique, The Music Center and Museum. Ses parents sa mère surtout est une folksinger accomplie. Il a été élevé dans un mode de guitares acoustiques, de banjos et s’est entiché de la Weissenborn dont il a fait son instrument de prédilection. Son Winter Is for Lovers est un album de guitare solo, 15 titres comme autant de villes autour du monde, un voyage musical envoûtant de 35 minutes et quelque d’invention et de rêveries sur « lap steel guitar ». Un beau voyage d’hiver.
Côté jazz, je suis toujours épaté par la richesse de la scène londonienne avec toutes ces musiques métissées d’influences tant caribéennes et africaines qu’américaines. Le ténor et leader Shabaka Hutchings est particulièrement actif et créatif, tant avec ses Sons of Kemet qu’avec ses Ancestors sud-africains avec qui il a fait paraître le « messianique » We Are Sent Here By history. Cet album magistral dont le magazine Pitchwork offre un brillant compte, se veut comme une prémonition à notre avenir assise sur une réflexion sur le passé. Les rythmes sont fous, la poésie écrite et scandée par Siyambonga Nthembu est puissante, le jeu de Shabaka tant au saxo ténor qu’à la clarinette est souvent saisissant. C’est à la fois incantatoire et dansant; la vie quoi!
Le confinement a, bien sûr, chamboulé la vie de tous et des musiciens en particulier. Pour certains, l’influence a été si notable qu’ils en ont fait une œuvre, comme le pianiste Brad Mehldau, qui a sorti cet album unique qui s’intituleSuite : April 2020, une série de mouvements comme autant de réflexions sur une journée au temps de la covid. Impressionnant comme exercice! Un de mes albums favoris de l’année. Il y a dans cette prestation, comme une bienveillance, une intériorité qui fait du bien. Le jazz est partout dans tous les aspects de la vie et Brad Mehldau est un des plus importants pianistes et compositeurs vivants.
Le dernier et non le moindre, le grand maître de la poésie contemporaine en chanson, Bob Dylan, a publié une sorte de somme de son époque, des années 1960 à aujourd’hui, Rough and Rowdy Ways. Foin de poésie ici, mais un regard pragmatique et inquiet sur le passé récent et l’avenir de son Amérique. L’album culmine avec Murder Most foul, une longue chanson, une litanie musicale, où il raconte que le meurtre de John F. Kennedy marque le début du déclin inexorable de son pays.
Dans une entrevue au journaliste Douglas Brinkley du New York Times, il confie, clairement et sans métaphores pour une fois, sa réflexion et ses appréhensions. Cet album, riche des musiques qu’il a affectionné et pratiqué toute sa vie durant, peut être vue comme une sorte de testament. Album essentiel s’il en est…